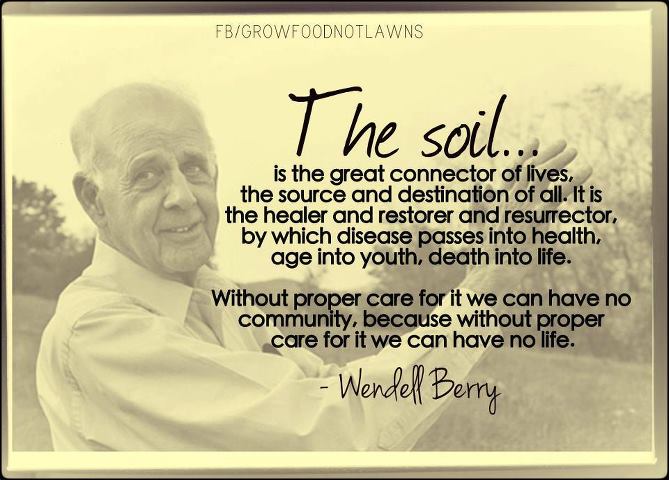La norme de la pensée agraire…
Par WENDELL BERRY
Le but de cette économie actuelle, comme le dit à juste titre Vandana Shiva, est de remplacer la «démocratie alimentaire» par une «dictature alimentaire» mondiale. Parce que l’industrialisme ne peut pas comprendre les êtres vivants, sauf en tant que machines, et ne peut leur accorder aucune valeur qui n’est pas utilitaire, il conçoit l’agriculture et la foresterie comme des mines; il ne peut pas utiliser la terre sans l’abuser.
Thomas Jefferson prévoyait déjà et craignait la division de notre peuple entre 2 types de colons, les gens qui voulaient «une petite partie de la terre» comme un foyer et, quasiment opposés à ceux-là, les consolidateurs, les exploiteurs de la terre et de la richesse de la terre, qui ne seraient pas retenus par ce que Jefferson a appelé «l’affection naturelle de l’esprit humain». Il a écrit cela en 1785 parce qu’il craignait exactement la théorie politique que nous avons maintenant: l’idée comptenporaine que le gouvernement existe pour garantir le droit des plus riches de posséder ou de contrôler la terre sans limite…
Texte original en anglais : https://orionmagazine.org/article/the-agrarian-standard/
Mon livre « L’inquiétude de l’Amérique » a été publié il y a vingt-cinq ans, en 1997. Il a fait l’objet de plusieurs réédition et est toujours lu. En tant qu’auteur, je serais tenté d’être content de cela, et pourtant, je continue le même combat, la situation étant encore plus grave aujourd’hui. Le livre aurait eu un sort beaucoup plus heureux s’il avait pu être réfuté ou devenu obsolète il y a quelques années, ce n’est pas le cas, mais cependant la prise de conscience de la situation par un plus grand nombre de personnes dans tous les milieux aujourd’hui est un aspect positif et sur lequel il convient de construire le futur.
Le contenu de mon livre reste vrai car les conditions décrites, les abus portés aux terres agricoles et contre les agriculteurs, ont persisté et se sont aggravés au cours des vingt-cinq dernières années.
En 2002, nous avons moins de la moitié du nombre d’agriculteurs aux États-Unis que nous avions en 1977. Nos collectivités agricoles sont dans un état bien pire maintenant qu’elles ne l’étaient alors. Nos taux d’érosion des sols continuent d’être insoutenablement élevés. Nous continuons à polluer nos terres et nos ruisseaux avec des poisons agricoles. Nous continuons à perdre des terres agricoles pour le développement urbain, comme un grand gaspillage. Les grandes entreprises agroalimentaires qui étaient principalement nationales en 1977 sont maintenant mondiales et remplacent la diversité agricole mondiale, qui était une richesse pour les agriculteurs et les consommateurs locaux, avec des monocultures bio-ingénieriées et brevetées qui sont uniquement rentables pour les entreprises.
Le but de cette économie actuelle, comme le dit à juste titre Vandana Shiva, est de remplacer la «démocratie alimentaire» par une «dictature alimentaire» mondiale.
Être un écrivain représentant de la « pensée du mouvement agraire » dans un tel moment historique est une expérience étrange. On continue de rédiger des essais et des discours que l’on préférerait ne pas écrire, que l’on souhaiterait s’avérer inutile, que l’on espère que personne ne trouvera plus nécessaire dans le quart de sièce prochain. Ma vie en tant qu’écrivain agraire m’a certainement introduit dans de grandes confusions, mais je n’ai jamais douté pendant une minute de l’importance de la cause que j’ai essayé de servir : l’espoir que nous pourrions redevenir des personnes saines dans une terre saine.
Nous, les agriculteurs, sommes impliqués dans un processus difficile, long et important, dans lequel nous sommes de loin, et de manière considérable, les grands perdants. Ce que nous avons entrepris de défendre, c’est l’accomplissement complexe de la connaissance, de la mémoire culturelle, de l’habileté, de la maîtrise de soi, du bon sens et de la décence fondamentale, un art élevé et indispensable pour lequel nous ne pouvons probablement pas trouver un meilleur nom qu’ «une bonne agriculture». Je veux dire l’agriculture telle que définie par l’agriculteur par opposition à l’agriculture définie par l’industrie: l’agriculture comme l’utilisation correcte et la responsabilité d’un don incommensurable.
Je crois que cette compétition entre l’industrialisme et l’agrarisme définit maintenant la différence humaine la plus fondamentale, car elle divise non seulement deux concepts d’agriculture et d’utilisation de la terre, mais aussi deux façons quasi opposées de nous comprendre, nous autres créatures et notre monde.
LA VOIE DE L’INDUSTRIALISME est le chemin de la machine. Pour l’esprit industriel, une machine n’est pas simplement un instrument pour faire du travail ou s’amuser ou faire la guerre, c’est une explication du monde et de la vie. Parce que l’industrialisme ne peut pas comprendre les êtres vivants, sauf en tant que machines, et ne peut leur accorder aucune valeur qui n’est pas utilitaire, il conçoit l’agriculture et la foresterie comme des mines; il ne peut pas utiliser la terre sans l’abuser.
L’industrialisme prescrit une économie et des manières de faire indifférenciées selon le lieu. Il ne distingue pas un lieu d’un autre. Il applique ses méthodes et ses technologies de manière indistincte dans l’Est ou l’Outest américain ou en Inde. Cela constinue ainsi l’économie du colonialisme.
Le paradigme de changement du pouvoir colonial de la monarchie européenne à la société mondiale est peut-être le thème dominant de l’histoire moderne. Il s’agit de tout rassembler le pouvoir économique dans les mains de quelques personnes étrangères aux lieux et aux personnes qu’ils exploitent. Une telle économie est destinée à détruire les économies agraires localement adaptées partout où elle se développe, simplement parce que ce type de pouvoir est trop ignorant pour ne pas le faire. Et il a réussi précisément dans la mesure où il a pu inculquer la même ignorance chez les travailleurs et les consommateurs.
Pour les employés corporatifs, politiques et académiques de l’industrialisme mondial, la petite ferme familiale et la petite communauté agricole ne sont pas connues, non imaginables et donc impensables, sauf en tant que stéréotypes dommageables pour leurs objectifs. Les gens de «pointe» en sciences, en affaires, en éducation et en politique n’ont aucune patience avec l’amour local, la loyauté locale et les connaissances locales qui rendent les gens vraiment originaux à leur place et donc de bons gardiens de leurs lieux. C’est pourquoi l’un des principaux principes de l’industrialisme a toujours été de faire disparaître le travailleur local. Dès le début, elle a été destructrice de l’emploi à domicile et de l’économie domestique. La fonction économique du ménage a été de plus en plus la consommation de biens achetés. Sous l’industrialisme, la ferme est devenue de plus en plus consommatrice et les fermes vont à l’échec car les coûts de la consommation surpassent les revenus de la production.
Le mépris industriel pour tout ce qui est petit, rural ou naturel se traduit par un mépris pour l’inconnu que constituent d’autres types de systèmes économiques, toute sorte d’autosuffisance locale dans les aliments ou autres nécessités. La «solution» industrielle pour de tels systèmes est d’augmenter l’échelle du travail et du commerce. Elle apporte de grands concepts, de l’argent et de la nouvelle et imposante technologie dans les petites communautés rurales, leurs économies et leurs écosystèmes – l’industrie intégrée et les experts étant invariablement étrangers et méprisant vis à vis des lieux où ils comptent se développer.
Il n’est jamais de question de convenance et de respect, pour chercher à adapter sa pensée, les buts ou la technologie au lieu. Le résultat est que les problèmes corrigibles à petite échelle sont remplacés par des problèmes à grande échelle pour lesquels il n’y a pas de corrections possibles. Entretemps, l’entreprise à grande échelle a réduit ou détruit la possibilité de corrections à petite échelle.
Cela décrit exactement notre agriculture actuelle. Forcer toutes les localités agricoles à se conformer aux conditions économiques imposées de loin par quelques grandes entreprises a causé des problèmes de la plus grande échelle possible, comme la perte de sol, l’appauvrissement génétique et la pollution des eaux souterraines qui ne peuvent être corrigées que par une agriculture composée localement des fermes petites variées, une correction qui, après un demi-siècle d’agriculture industrielle, sera difficile à réaliser.
L’économie industrielle est donc intrinsèquement violente. Elle appauvrit un endroit pour être extravagante dans un autre, fidèle à son ambition colonialiste. Une partie du coût “extériorisé” de ceci est la guerre.
L’INDUSTRIALISME COMMENCE AVEC l’invention technologique. Mais l’agrarisme commence par des données concrètes liées à la vie et à son respect : la terre, les plantes, les animaux, la météo, la faim et la connaissance des particularités d’origine de l’agriculture. Les industriels sont toujours prêts à ignorer, à vendre ou à détruire le passé afin d’obtenir la richesse, le confort et un bonheur totalement sans précédent qui se trouvent dans l’avenir.
Les agriculteurs agriens savent que leur identité dépend de leur volonté de recevoir avec gratitude, d’utiliser de manière responsable et de laisser intact un héritage, tant naturel que culturel, depuis le passé. J’ai dit il y a quelque temps que l’agriculture agraire est l’utilisation et le soin appropriés d’un cadeau incommensurable.
Le moyen le plus simple de comprendre cela, je suppose, est la manière religieuse. Parmi les lieux communs de la Bible, par exemple, sont les admonitions que le monde a été créé et approuvé par Dieu, qu’il lui appartient, et que ses bonnes choses nous sont offertes en cadeaux à tous les hommes, l’idée que toute la Création n’existe qu’en participant à la vie de Dieu, en partageant son être, en respirant son souffle. “Le monde”, a déclaré Gerard Manley Hopkins, “est chargé de la grandeur de Dieu”. Certaines de ces pensées auraient été familières pour la plupart des gens pendant la plus grande partie de l’histoire humaine.
Il nous semble étrange que ce qui nous a éloignés de Dieu, c’est notre économie. L’économie industrielle n’aurait pas pu être plus éloignée de cette pensée qu’elle est éloignée de la règle d’or des architectes antiques.
Si nous pouvions croire vraiment que l’existence du monde est enracinée dans le mystère et dans la sainteté, alors nous aurions une économie différente. Ce serait encore une économie d’utilisation, nécessairement, mais ce serait aussi une économie de retour. L’économie devrait tenir compte de la nécessité d’être digne vis à vis des dons que nous recevons et utilisons, ce qui impliquerait des éloges, des remerciements, des responsabilités, un bon usage, de bons soins et une bonne considération pour l’enfant à naître.
Ce qui est plus visiblement absent de l’économie industrielle et de la culture industrielle, c’est cette idée de retour. Les humains industriels se comportent avec le monde et ses créatures avec des actes de violence très directs. La plupart du temps, nous prenons sans demander, utilisons sans respect ni gratitude et ne donnons rien en retour.
Comprendre le monde et notre vie comme des cadeaux de sainteté, c’est être les témoins que notre économie humaine est le symptome d’une crise morale continue. Notre vie de besoin et de travail nous oblige inévitablement à utiliser dans le temps des choses appartenant à l’éternité et à assigner des valeurs finies à des choses déjà reconnues comme infiniment précieuses. C’est une situation terrible. Elle appelle à la prudence, à l’humilité, au bon travail, à une mesure de l’échelle de nos actes et décisions. Elle appelle des responsabilités complexes de la prise en charge et de la remise en cause en lien avec la compréhension du mot «intendance».
L’idée de la valeur incommensurable de toute ressource est centrale : le thème ancien du petit agriculteur ou laboureur qui mène une vie abondante sur une « banquise » souvent décrite comme rejetée ou pauvre. Cette figure fait sa première apparition littéraire, à ma connaissance, dans le Quatrième Georgique de Virgil: j’ai vu un homme, un vieux cilicien, qui occupait un acre ou deux de terre que personne ne voulait, une terre qui ne vaut pas le labour, sans récompense pour les troupeaux, inapte aux vignobles; il la prépare cependant, en plantant ici et là parmi les glaçages, les lys blancs et la verveine. Et les papillons fragiles, se prenaient pour des rois. Un thème agraire qui a été porté depuis les premiers temps jusqu’à présent principalement dans la tradition familiale ou folklorique. Partout où ils se trouvent, ils ne varient pas beaucoup du prototype de Virgil. Ils n’ont pas ou n’ont pas besoin de beaucoup de terre, et le terrain qu’ils possèdent est souvent marginal. Ils pratiquent l’agriculture de subsistance, qui a été très ridiculisée par les économistes agricoles et les autres savants de l’ère industrielle et ils associent toujours la frugalité à l’abondance.
Dans mes divers voyages, j’ai vu un certain nombre de petites propriétés comme celle du vieux fermier de Virgil, situées sur une «terre que personne ne voulait» et pourtant productive de nourriture, de plaisir et d’autres biens. “Même maintenant, s’ils se donnaient de la peine, je pense que les économistes agricoles pourraient trouver des petits agriculteurs qui ont prospéré, non pas en« grandissant », mais en pratiquant les anciennes règles d’épargne et de subsistance, en acceptant les limites de leurs petites fermes et en sachant bien la valeur d’avoir un peu de terre.
Comment venons-nous à la valeur d’un petit terrain? Nous le faisons, en suivant ce volet de la pensée agraire, par référence à la valeur de l’absence de terre. « Les Agrarians » valorisent les terres parce que quelque part dans l’histoire de leur conscience existe le souvenir d’avoir été sans terre. Ce souvenir est implicite, dans le poème de Virgil, dans l’acceptation heureuse de l’ancien fermier d’un acre ou de deux terres que personne ne voulait. Si vous n’avez pas de terre, vous n’avez rien: pas de nourriture, pas d’abri, pas de chaleur, pas de liberté, pas de vie. Si nous nous rappelons cela, nous savons que toutes les économies commencent à mentir dès qu’elles attribuent une valeur fixe à la terre. Les gens qui ont été sans terre savent que la terre est inestimable; elle est l’essence de la vie. Les humains pré-agricoles, bien sûr, le savaient aussi évidemment. Il est effrayant d’être sans un «territoire».
Tout ce que le marché peut dire, la valeur de la terre ne détruira jamais en réalité ce qu’elle a toujours été: la source de l’accès à la nourriture, l’habillement, l’abri et à la liberté. La terre vaut ce que la vie vaut… !
Cette perception a déplacé les colons de l’Ancien Monde vers le Nouveau. La plupart de nos ancêtres américains sont venus ici parce qu’ils savaient ce que signifier être sans terre. Être sans terre, c’est être menacé par le besoin et aussi par l’asservissement. En venant ici, ils portaient le souvenir ancestral du servage. Sous la féodalité, les quelques-uns qui possédaient la terre possédaient aussi, par une logique politique incontournable, les gens qui travaillaient dans la terre.
Thomas Jefferson, qui connaissait toutes ces choses, pensait évidemment à celles-ci quand il a écrit en 1785 que «ce n’est pas trop tôt dans l’histoire, de réaliser, par tous les moyens possibles, que le plus petit nombre possible ne se trouve sans une petit portion terre à cultiver. Les petits propriétaires fonciers sont la partie la plus précieuse d’un État… ” disait-il, deux ans avant l’adoption de notre constitution, « un État démocratique et des libertés démocratiques dépendent de la propriété démocratique de la terre ».
Il prévoyait déjà et craignait la division de notre peuple entre 2 types de colons, les gens qui voulaient «une petite partie de la terre» comme un foyer et, quasiment opposés à ceux-là, les consolidateurs, les exploiteurs de la terre et de la richesse de la terre, qui ne seraient pas retenus par ce que Jefferson a appelé «l’affection naturelle de l’esprit humain». Il a écrit cela en 1785 parce qu’il craignait exactement la théorie politique que nous avons maintenant: l’idée comptenporaine que le gouvernement existe pour garantir le droit des plus riches de posséder ou de contrôler la terre sans limite.
Dans toute considération d’agrarisme, cette question de limitation est essentielle. Les agriculteurs agraires voient, acceptent et vivent dans leurs limites. Ils comprennent et acceptent la proposition selon laquelle il y a “autant et pas plus”. Tout ce qui se passe sur une ferme agraire est déterminé ou conditionné par la compréhension qu’il n’y a que tant de terre, tant d’eau dans la citerne, tant de foin dans la grange, tant de maïs dans le berceau, tant de bois de chauffage dans le hangar, tant de nourriture dans la cave ou le congélateur, tant de force dans le dos et les bras – et pas plus. C’est cette compréhension qui induit l’épargne, la cohérence familiale, le voisinage, les économies locales. Dans les limites acceptées, elles deviennent des nécessités. Le sens agraire de l’abondance provient de la possibilité expérimentée de la frugalité et du renouveau dans les limites. Ceci est exactement contraire à l’idée industrielle que l’abondance provient de la violation des limites par la mobilité personnelle, les machines extractives, le transport à longue distance et les percées scientifiques ou technologiques – Si nous utilisons et peut-être épuisons les bonnes potentialités d’un lieu, nous importerons des marchandises d’un autre endroit, ou nous irons à un autre endroit – Si la nature libère ses richesses trop lentement, nous la prendrons par la force – Si nous rendons le monde trop toxique pour les abeilles, un cerveau composé, Monsanto peut-être, va inventer de minuscules robots qui vont voler sur les fleurs pollinisantes et faire du miel…
Être sans terre dans une société industrielle, implique pour survire qu’il faut évidemment ne pas être sans emploi et sans logement. Mais la capacité de l’économie industrielle à fournir des emplois et des foyers dépend de la prospérité et d’une prospérité très fragile. Cela dépend de la «croissance» des mauvaises choses – ce que Edward Abbey appelait «l’idéologie de la cellule cancéreuse» – et sur la cupidité lié au pouvoir d’achat. En l’absence de croissance, d’avidité et d’affluence, les hommes qui dépendent d’une économie industrielle souffrent trop facilement des conséquences de l’absence de terres: le chômage, l’itinérance et la pauvreté.
Ce n’est pas une théorie. Nous voyons les limites de ce modèle devant nos yeux.
Je ne pense pas que l’atterrissage nécessairement signifie posséder des terres. Cela signifie en tout cas être relié à un paysage domestique à partir duquel on peut vivre par des interactions avec une économie locale et sans l’intervention routinière des gouvernements, des grandes entreprises ou des organismes de bienfaisance. A notre époque, il est inutile et probablement faux de supposer qu’un grand nombre de personnes vivant en condition urbaine devrait sortir dans la campagne et devenir des propriétaires ou des agriculteurs. Mais il n’est pas inutile de supposer que les personnes urbaines ont des responsabilités agricoles, qu’elles devraient essayer de reconnaître et d’assumer. Dans les faits, cela est en train de se produire.
La population qui adhère à la pensée « agraire » parmi nous est de plus en plus grande, elle ne comprend pas seulement certains agriculteurs et certains pays. Elle comprend les jardiniers urbains, les consommateurs urbains qui achètent de la nourriture des agriculteurs locaux, les consommateurs qui ont mis en doute la qualité, les dangers pour la santé et la fiabilité du système alimentaire des entreprises agroalimentaires – en d’autres termes, qui comprennent ce que signifie « être sans terre » .
Wendell Berry vit et travaille avec sa femme, Tanya Berry, dans leur ferme à Port Royal, au Kentucky. Éditeur, romancier et poète, il est l’auteur de plus de trente livres. Berry a reçu de nombreux prix, dont le Prix T. S. Eliot, le John Hay Award, le Prix Lyndhurst et le Prix Aiken-Taylor. Ses livres comprennent le classique The Unsettling of America, Andy Catlett, Early Travels, et The Selected Poems de Wendell Berry.